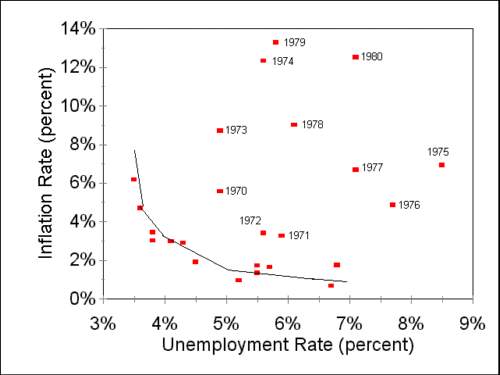C'est pas ma faute
Eh bien, oui, pourquoi donc ? C'est le coût de la vie depuis l'introduction de l'euro, pardi ! Enfin, c'est ce qu'on entend souvent au café du commerce, ou qu'on peut lire sur la page Facebook de Gisèle. Sauf que la participation d'un nombre toujours plus grand de femmes au marché du travail est un phénomène qui date de bien avant l'euro (voir graphique ci-dessous), et coïncide en fait avec une augmentation du niveau de vie. |
| Taux d'activité par sexe - 1975-2018 - Source: Insee |
 |
| Smile ! (Source: Fonds Monétaire International) |
Cette réduction initiale s'expliquerait par un effet de richesse, le ménage profitant de l'augmentation de revenus pour consacrer sa force de travail au travail domestique non rémunéré (pour s'occuper plus des enfants, avoir une maison plus belle, etc.), couplé selon Goldin à une aversion culturelle à voir une femme travailler à l'usine. Puis, dans une phase de développement plus avancée, cette tendance s'inverse. En effet, les revenus réels ne cessent d'augmenter, ce qui veut dire que chaque euro (ou franc avant) achète année après année une quantité toujours plus importante de biens et services. Il y a donc ce qu'on appelle un coût d'opportunité pour le foyer qui choisit de voir la femme ne pas participer au marché du travail. Autrement dit il faut que ça vaille le coup (avec un "p" cette fois) en termes de réduction de consommation !
Das Leben der Anderen
On voit cependant dans graphique ci-dessus que les données récentes (similaires à celles de Goldin) sont très bruitées et que ce qu'on avance tient plus de l'intuition que du fait certain. Car en ne considérant que la dimension économique directe (via le PIB par habitant), on néglige les attitudes culturelles, qui jouent un rôle prépondérant dans l'entrée des femmes dans la population active.Un exemple frappant est celui de la différence entre Allemagne de l'Est et de l'Ouest, qui persiste même près de trente ans après la réunification. Un papier récent repéré par le biais de Martin Anota étudie les écarts de taux d'activité entre Est- et Ouest-allemandes, et confirme que les premières participent bien plus au marché du travail que les secondes, ce qui s'explique par l'ancrage dans les mentalités de la politique familiale plus égalitariste du régime communiste par rapport à l'autre moitié de l'Allemagne, où prendre moins de 3 ans de congé maternité c'est être une mère indigne.
Et c'est tout ce qui reste de notre héritage culturel
 |
| Mon mari? What else? (c) The Guardian |
Ceci nous pousse donc à essayer d'enquêter de façon un peu plus systématique ce qu'avance Claudia Goldin, par le biais d'une analyse statistique rapide. On se concentre sur les pays développés (la partie croissante de la courbe en U, pertinente pour la France) et essayer de déterminer à quel point le niveau revenu (ou le coût d'opportunité qui est associé à leur absence) joue dans le choix d'entrer ou de rester dans la vie active, toutes choses égales par ailleurs.
Cependant, comme il est impossible d'observer le salaire des femmes qui ne travaillent pas (par définition), on utilise le niveau d'étude comme approximation du niveau de revenu, un diplôme plus élevé se traduisant en moyenne par un niveau de revenu plus haut.
Utilisant cet indicateur, la variable dépendante est le taux d'activité pour 2017, observé au sein des pays de l'OCDE (des pays riches donc), selon trois niveaux d'études (moins que le lycée/au plus le lycée/études supérieures).
Ensuite, pour essayer de contrôler les effets culturels, on régresse aussi sur les composantes du Gender Inequality Index compilé par l'ONU, (à l'exclusion du taux d'activité des femmes), pour chaque pays de l'échantillon. On contrôle aussi pour l'hétérogénéité des pays considérés en ajoutant le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat.
Avec cette spécification, qui donne une bonne qualité d'ajustement (R2 de 80%), on trouve que le niveau d'éducation est un facteur très positif de la participation au marché du travail pour les femmes (ce qu'on pouvait déjà voir sans régression vu que le taux d'activité est systématiquement croissant avec le niveau de diplôme). Mais bien sûr les attitudes culturelles jouent aussi un rôle important, comme le montre les contributions de la proportion de femmes ayant au moins un diplôme équivalent au niveau lycée et de la proportion élues au parlement (0,37 et 0,20 points d'augmentation du taux d'activité respectivement pour un point d'augmentation).
De toutes ces délibérations, on conclut que si ma femme travaille, ça n'a rien à voir avec l'euro (demandez à votre tendre moitié, elle vous jettera aussi un regard interloqué), et pas uniquement grâce à la remise en cause de la société patriarcale traditionnelle, mais bel et bien parce que deux revenus, c'est mieux !
Les données brutes et la régression sont disponibles ici.
-----------------------------------------------------------------------------------
1. Le taux d'activité, qui représente la proportion de la population active (c'est-à-dire qui travaille ou en recherche d'emploi) par rapport à la population en âge de travailler, est la variable pertinente ici, car elle mesure la proportion de femmes qui participent au marché du travail, en dehors du travail domestique.




.gif)